Pour son nouveau long-métrage Bugonia, Yórgos Lánthimos ne s’est pas contenté de changer de registre narratif. En collaboration avec son directeur de la photographie Robbie Ryan, BSC, ISC il a opéré un choix technique radical qui fera date : tourner l’intégralité ou presque d’un huis clos « sale » dans le format le plus noble et le plus coûteux du 35mm. Analyse d’un parti-pris visuel extrême où la texture de la pellicule devient le troisième personnage du film.
Le choix du « Grand Format » argentique
Si l’histoire de Bugonia — un enlèvement paranoïaque dans un sous-sol — semblait appeler une esthétique brute type 16mm ou Super 35, le duo Lánthimos/Ryan a pris le contre-pied total des attentes. La conférence a confirmé une donnée technique majeure : le film a été tourné « sur du film 35 mm à 8 perforations avec des caméras VistaVision ».
Pour les chefs opérateurs, ce détail est crucial. Le VistaVision, format horizontal offrant une surface de négatif immense (équivalente au Full Frame en numérique, mais avec la texture organique du film), est historiquement réservé aux grands paysages ou aux effets spéciaux (avant le numérique). Robbie Ryan estime qu' »environ 95 % du film a été tourné en VistaVision », une prouesse technique qui signifie que la production « a utilisé ce format plus que n’importe quel film depuis La Vengeance aux deux visages (One-Eyed Jacks) en 1961″.
Ce choix implique une logistique lourde (le bruit des caméras Beaumont ou ARRI modifiées, la consommation de magasin doublée), mais il promet un piqué et une finesse de grain exceptionnels, créant une dissonance visuelle fascinante avec la crasse du décor principal.
Texture et matière : filmer l’organique
L’apport du 8-perf prend tout son sens lorsqu’on s’attarde sur le travail des textures décrit durant la présentation. Le film est un huis clos organique. Le personnage d’Emma Stone subit une transformation physique violente : elle « s’est rasé la tête pour ce rôle » et passe une grande partie du film avec « son corps couvert de crème antihistaminique ».
Le VistaVision, avec sa faible profondeur de champ et sa résolution massive, va permettre de scruter ces détails — la peau irritée, la texture de la crème, le crâne nu — avec une précision chirurgicale, presque clinique. C’est ici que réside l’intérêt cinématographique : traiter un sujet de « série B » (un alien dans une cave) avec la majesté d’une épopée visuelle.
Gestion des décors : du sous-sol sombre à la lumière aveuglante de la Grèce
La photographie du film semble construite sur une rupture de contraste violent. La majeure partie du film se déroule dans l’obscurité confinée du sous-sol de Teddy. Cependant, le final a imposé un défi de lumière naturelle radical.
Lánthimos souhaitait initialement tourner la séquence finale sur l’Acropole, mais « le Conseil archéologique central de Grèce a rejeté sa demande ». L’équipe a dû pivoter vers « la plage de Sarakiniko sur l’île grecque de Milos ».
Pour un chef opérateur, ce lieu est un défi d’exposition : c’est un paysage lunaire de roche volcanique blanche, agissant comme un réflecteur géant sous le soleil méditerranéen. Le passage de la cave sombre à cette blancheur immaculée pour la scène où Michelle « fait éclater un dôme transparent… tuant instantanément tous les humains » promet une rupture tonale et lumineuse saisissante.
Un budget au service de l’image
L’exigence du format VistaVision a un coût, et Bugonia ne s’en cache pas. Il a été révélé que le film « a coûté 55 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher de Lánthimos ».
Ce budget a permis de sécuriser le stock de pellicule nécessaire pour tourner en 8-perf, mais aussi de gérer des tournages complexes « à High Wycombe, en Angleterre, et à Atlanta, en Géorgie », avant de partir pour la Grèce. C’est une démonstration rare, à l’ère du numérique, qu’une production moderne peut encore miser une part significative de son budget sur le support de captation lui-même pour servir la vision artistique.

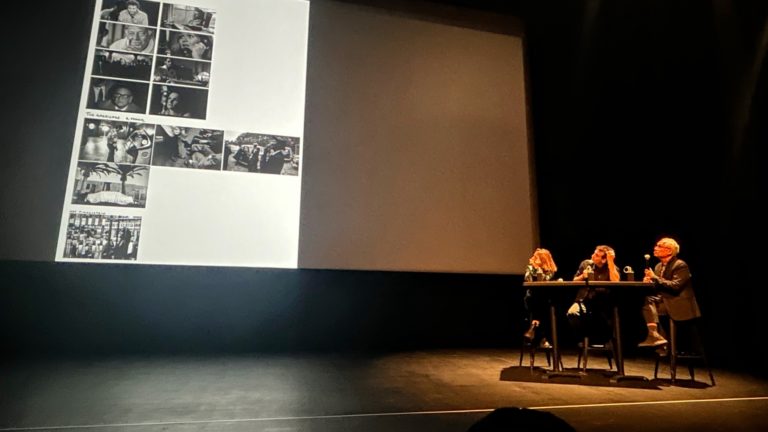

![Camerimage 2023 Pauvres Créatures [Poor Things] de Yórgos Lánthimos : corps déviant, esprit d’auteur](https://www.ucocinematographie.org/wp-content/uploads/resized/2023/12/img_3749-1-768x432-c-center.jpeg)